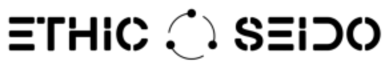17 ene. 23

Tiempo estimado de lectura:min
Contraindre ou inciter, l’épineuse gestion des déserts médicaux en France
Lionel Cavicchioli, The ConversationLes gouvernements successifs ont tous buté sur le problème des déserts médicaux. Comment faire reculer ces zones géographiques où l’accès aux soins est difficile ? De quels outils disposent les décideurs pour y parvenir ? Certaines solutions ont-elles déjà fonctionné ? Spécialiste du droit de la santé, Guillaume Rousset nous propose quelques pistes de réflexion.
Avant tout, peut-être faut-il se poser la question de ce que l’on appelle « désert médical » ?
L’expression « désert médical » relève davantage de la formule médiatique que d’un concept scientifique ou académique.
Plusieurs aspects me semblent problématiques. Tout d’abord le mot désert renvoie à une idée « d’aridité de tout » : on a en tête l’image d’Épinal du village de campagne qui, après avoir vu fermer son école, sa poste, son épicerie, se voit privé de son cabinet médical. Certes, un certain nombre de territoires ruraux sont confrontés à ce type de situation, mais il s’agit en réalité d’une problématique qui concerne tous les territoires, pas uniquement les campagnes. Des déserts médicaux peuvent se développer dans les centres de certaines villes, ou dans les territoires périurbains, malgré une densité de population importante et un tissu économique (commerces) conséquent.
En outre, la question n’est pas uniquement territoriale. Celle du temps se pose également : je peux habiter dans une ville où exerce un spécialiste, si je dois attendre plusieurs mois pour avoir un rendez-vous, alors je rencontre également des difficultés d’accès aux soins. Autre problème : l’accès à certains équipements comme les dispositifs d’imagerie par exemple. En outre, dans le cas de l’accès à la télémédecine, la problématique des déserts médicaux rencontre celle des déserts numériques.
Tout cela souligne la diversité de la notion, qui ne se résume pas à l’accès aux consultations ou à la présence sur le territoire de professionnels de santé.
Par ailleurs, le mot « médical » est réducteur. Il évoque le seul médecin généraliste (même si, selon le Code de la santé publique, les professions médicales sont : médecin, sage-femme et odontologiste). Bien entendu, on manque avant tout de généralistes, qui sont les médecins du quotidien. Mais toutes les professions de santé sont concernées par ces questions de densité insuffisante, y compris les professions paramédicales : masseurs kinésithérapeutes, infirmières ou même les pharmaciens d’officine…
Pour toutes ces raisons, il vaut mieux employer le terme « inégalités territoriales de santé », au même titre qu’il existe des inégalités économiques ou sociales de santé.
D’ailleurs, les travaux les plus récents montrent que les inégalités territoriales de santé se croisent aussi avec inégalités socio-économiques. Les personnes qui se trouvent en situation de vulnérabilité économique sont souvent plus à risque de se retrouver dans un territoire qui est par ailleurs un « désert médical ». Qui plus est, elles manquent parfois des moyens qui leur permettraient d’accéder aux soins, tel qu’un véhicule pour se déplacer au cabinet médical ou un ordinateur pour accéder aux services de télémédecine.
Comment la perception de la situation des déserts médicaux a-t-elle évolué ces dernières années ?
La question des inégalités territoriales de santé est une question qui me paraît de plus en plus médiatisée. C’est devenu le cheval de bataille de diverses personnalités politiques, car elle permet de répondre à certaines préoccupations de la population de manière forte. Les citoyens se mobilisent également.
Un exemple frappant est la création de l’« Association des citoyens contre les déserts médicaux », qui a vu le jour dans la Sarthe. Après avoir envoyé en début d’année un courrier au Premier ministre, resté sans réponse, ses représentants ont formé un recours auprès du Conseil d’État.
Selon eux, l’existence de déserts médicaux est contraire à un certain nombre de règles législatives mais aussi constitutionnelles, notamment l’alinéa 11 du préambule de la constitution de 1946 qui précise que la Nation garantit à tous « la protection de la santé ».
Quelles sont les origines des déserts médicaux
Ces dernières années, plusieurs éléments ont été avancés pour les expliquer. La conception de la vie professionnelle par les jeunes médecins a évolué, ils n’ont plus forcément envie d’exercer leur métier de façon solitaire, ils privilégient davantage le travail collectif et les interactions avec les autres professionnels, que ce soit à l’hôpital ou dans une maison de santé pluriprofessionnelle.
En outre, la majorité des médecins nouvellement diplômés aujourd’hui sont des femmes. C’est un fait neutre, qui n’est ni positif ni négatif. Cependant, le constat est qu’en l’état actuel de la société, ce sont encore essentiellement les femmes qui s’occupent des enfants durant les premières années. Exercer seule, dans un cabinet en libéral, est plus compliqué que de s’installer avec d’autres professionnels ou de choisir le salariat.
Troisième point : le rapport à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle a changé. On trouve de moins en moins de médecins désireux de travailler 70 heures par semaine, même contre un revenu est plus important. Une fois encore, on constate que les agendas moins chargés sont privilégiés, quand bien même cela passe par un exercice en cabinet collectif ou à l’hôpital.
Enfin, certains avancent parfois l’idée que les médecins privilégient désormais les installations dans des structures collectives pour échapper à ce qu’ils perçoivent comme une certaine forme d’alourdissement administratif.
Comment les autorités envisagent-elles de remédier au problème ?
Historiquement, deux tendances se sont dessinées. La première était fondée sur la notion d’incitation. Il s’agissait de donner envie aux professionnels de s’installer sur un territoire en déficit, via des incitations financières ou matérielles : prime d’installation, exonération fiscale, exonération sociale. Certains maires sont allés jusqu’à démarcher des médecins roumains, parce que francophones, pour les inciter à venir s’installer en France.
Cette approche présente l’avantage de la liberté d’installation (laquelle est protégée par la loi depuis 2010). Malheureusement, la Cour des comptes a souligné le fait qu’elle n’est pas suffisamment efficace en regard des sommes investies. En effet, le dispositif trouve rapidement ses limites : difficile de convaincre un professionnel de s’installer sur un territoire où ses proches ne pourront pas trouver d’emploi, où il lui sera difficile de scolariser ses enfants au-delà de l’école primaire, et où la vie culturelle ou sociale n’est pas celle à laquelle il aspire…
Une deuxième approche a donc été envisagée, plus coercitive, via le contrat santé solidarité. L’Agence régionale de santé invitait les médecins à venir s’installer en territoire sous-dense. S’ils acceptaient, le contrat était signé. S’ils refusaient, ils devaient payer une pénalité de 3000 €. Si la loi a bien été votée 2009, la contestation des médecins a été si intense que la ministre de la Santé de l’époque, Roselyne Bachelot, s’est engagée à ne jamais prendre les décrets d’application de la mesure. Puis, en 2010, la loi Fourcade a supprimé la pénalité, ce qui vidait la mesure de sa substance.
On le voit, politiquement s’attaquer à la liberté d’installation des médecins est compliquée. En outre, la question de la coercition est complexe. Celle-ci pourrait en effet avoir l’effet inverse de celui escompté, si par exemple elle amenait à détourner les médecins de l’exercice de la médecine libérale.
Les choses se sont passées différemment dans le cas des infirmières. L’Assurance-maladie a négocié avec les syndicats, dans le cadre de la convention, pour mettre en place ce que l’on appelle le conventionnement sélectif. S’il demeure possible de s’installer n’importe où sur le territoire, dans les zones où il y a trop d’infirmiers, pour être conventionné (et donc voir ses actes remboursés par la sécurité sociale) il faut s’installer à la place de quelqu’un qui part. Cette coercition qui ne dit pas son nom a été acceptée en contrepartie une revalorisation des tarifs.
Entre incitation et coercition, une troisième voie existe, qui est celle de l’accompagnement. Le meilleur exemple en est les maisons de santé pluriprofessionnelle. Outre une incitation financière, ce modèle propose aux soignants de travailler au sein d’un collectif médical associant médecins généralistes, masseur-kinésithérapeute, infirmier, éventuellement une sage-femme, un psychologue et dans l’idéal une pharmacie. Le tout autour d’un projet de soins. On crée ainsi une dynamique collective d’interdisciplinarité.
Cette approche se développe depuis une dizaine d’années et rencontre un certain succès. Il a été montré qu’elle améliore l’accès aux soins. Mais elle repose sur un soutien financier fort des pouvoirs publics et ne fonctionnerait pas sans cela. Ce qui n’est pas forcément négatif : on peut considérer qu’il s’agit de sommes investies, dans le cadre de la mission de protection de la santé des populations qui incombe à l’État.
Malheureusement, cette approche ne fonctionne pas partout : il existe des endroits où même en collectif, les professionnels de santé refusent de s’installer. C’est probablement le cœur de la question : les inégalités territoriales de santé ne sont qu’une facette d’un problème plus large d’aménagement du territoire. Il semble illusoire d’espérer les réduire sans s’en saisir globalement. Comment exiger des personnels soignants qu’ils s’installent dans des territoires ruraux ou périurbains où les pouvoirs publics ont parfois fermé la poste, l’école, et les services publics et où les commerces ont baissé le rideau ?![]()
Lionel Cavicchioli, Chef de rubrique Santé + Médecine, The Conversation,Guillaume Rousset, Maître de conférences en droit, HDR, Université Jean-Moulin Lyon 3
Nous remercions les auteurs ainsi que The Conversion pour l'autorisation de republication.